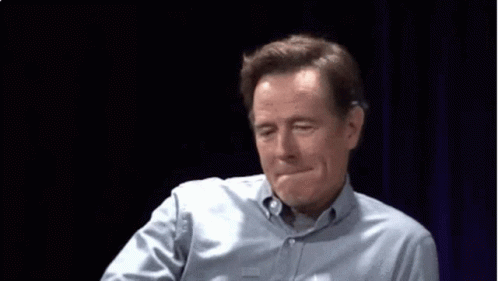IA et lecture : accompagner la transformation plutôt que la combattre
Sommes-nous vraiment prêts à sacrifier notre capacité à penser profondément au profit d'une prétendue commodité ?

L'intelligence artificielle transforme nos façons de travailler et d'apprendre, nous nous trouvons face à un paradoxe significatif : l'essor de l'IA générative coïncide avec le déclin de la lecture approfondie.
Sauf que ça, c’est pas génial. Ce constat soulève des questions essentielles sur notre rapport au savoir et à l'effort intellectuel.
Le double constat : IA omniprésente, lecture en déclin.
Selon le National Assessment of Educational Progress (NAEP) dans son rapport de 2020, seuls 17% des jeunes américains de 13 ans déclaraient lire quotidiennement pour le plaisir, contre 27% en 2012 et 35% en 1984 lors du début de cette collecte de données. J’aurai aimé parler de données françaises, mais elles sont bien cachées …
Parallèlement, l'utilisation d'outils d'IA comme ChatGPT se démocratise rapidement dans les milieux éducatifs et professionnels. Avec quasiment un usage systématique lors des phases de réflexions préliminaires.
Ces deux tendances reflètent une même réalité : notre tendance naturelle à minimiser l'effort cognitif.

La lecture longue demande concentration et persévérance. L'IA promet d'automatiser des tâches intellectuelles complexes.
Dans un monde où l'attention est une ressource rare et disputée, cette convergence mérite une analyse approfondie. Entrecoupée de publicités avec des chatons sur nos smartphones.
Former à l'ère de l'IA : accompagner plutôt que résister.
En tant que formateurs et éducateurs, il serait illusoire de croire que nous pouvons contrer l'avancée de l'IA avec des méthodes traditionnelles. Les interdictions d'utilisation de ChatGPT dans certaines classes sont aussi vaines que l'étaient les tentatives d'empêcher l'usage des calculatrices il y a quelques décennies.
L'histoire nous montre que ce cycle de rejet puis d'adoption est récurrent face aux innovations technologiques.
Lorsque l'imprimerie de Gutenberg s'est développée au XVe siècle, de nombreux scribes et autorités religieuses ont d'abord résisté, craignant la diffusion incontrôlée du savoir et la perte de leur statut privilégié. Il était impossible d’accepter que le saint savoir de la Bible puisse être partagé grâce à une machine et non un sachant.
Certains prédisaient même que cette mécanisation de l'écriture conduirait à l'appauvrissement de la pensée. Pourtant, l'imprimerie a finalement démocratisé le savoir et catalysé la Renaissance.
Notre rôle doit évoluer vers un accompagnement du changement. Il ne s'agit pas de résister à l'inévitable, mais de comprendre les limites de ces technologies pour mieux préparer nos apprenants.
L'importance du recul et de la connaissance.
La simple présence d'une technologie ne garantit pas son utilisation optimale. L'IA n'est pas destinée à remplacer l'intelligence humaine, mais à l'augmenter. Cette nuance est fondamentale et nécessite une compréhension approfondie des mécanismes sous-jacents.
Les formateurs doivent développer une double expertise : maîtriser suffisamment ces outils pour en comprendre les possibilités et les limites, tout en préservant une perspective critique qui permet d'évaluer leur pertinence dans différents contextes.
Cette distance réflexive ne peut s'acquérir que par l'étude, l'expérimentation et le dialogue avec d'autres praticiens. Et surtout : des moyens pour tester le résultat et la technique.

L'anthropologue des technologies Sherry Turkle du MIT a écrit dans son ouvrage "Seuls ensemble" (2011) : "La technologie n'est pas neutre, elle nous incite à adopter certains comportements et à en abandonner d'autres."
Cette observation nous rappelle l'importance d'une approche consciente et réfléchie de l'intégration de l'IA dans nos pratiques éducatives. Sans cette conscience, nous risquons de laisser la technologie façonner notre pédagogie plutôt que de la mettre véritablement au service de nos objectifs éducatifs.
Et ça, c’est pas top-top.
La transparence comme pilier de la confiance
Pour maintenir l'équilibre entre utilisation de l'IA et développement des capacités cognitives, la transparence devient essentielle. J’ai d’ailleurs lancé un site web à ce sujet : https://transparence-ia.com/
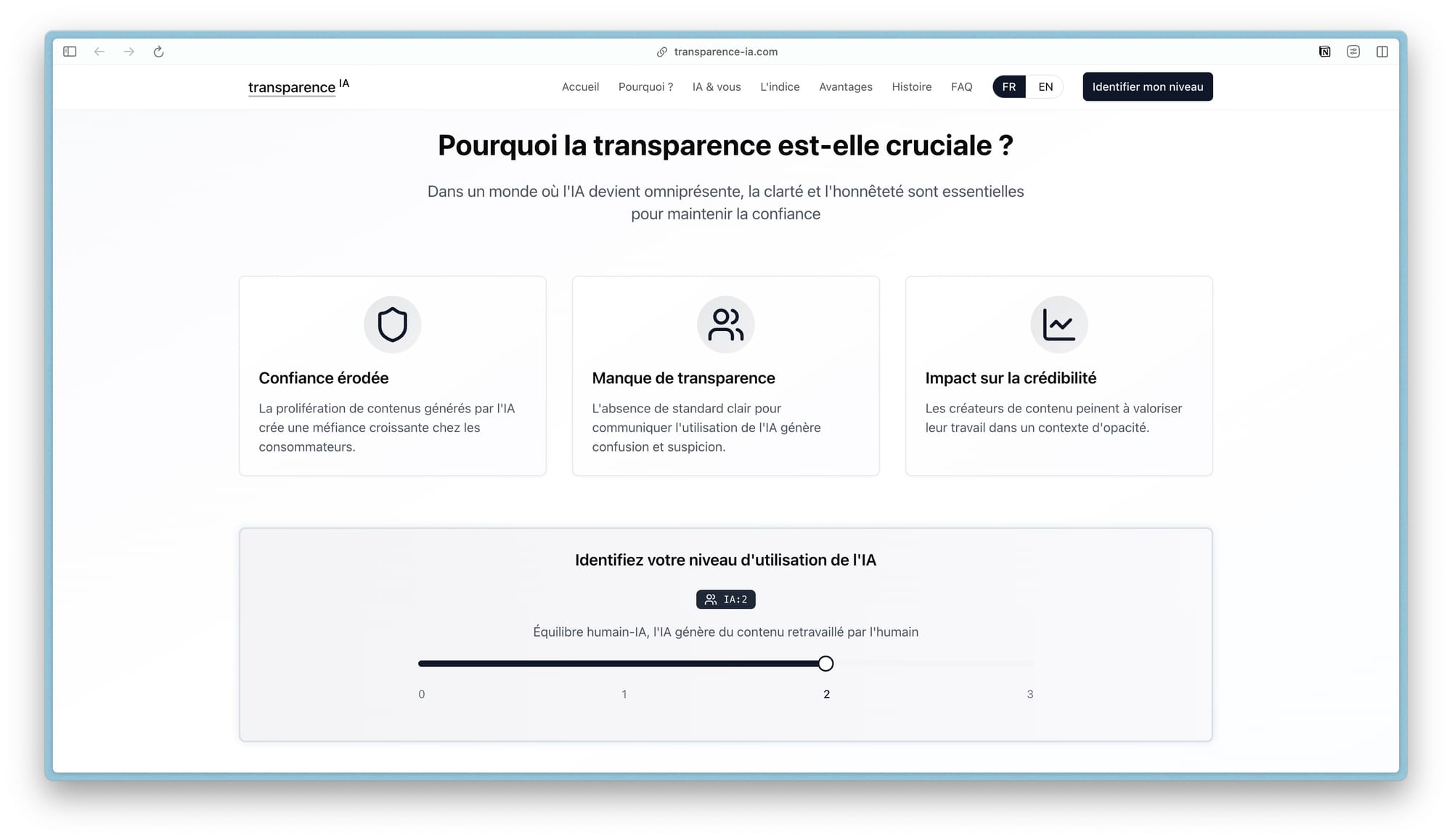
Un parallèle intéressant existe avec l'introduction de la photographie au XIXe siècle. À ses débuts, les photographies étaient souvent présentées comme des représentations fidèles de la réalité, alors que les photographes manipulaient déjà leurs images en laboratoire.
Il a fallu plusieurs décennies pour que se développe une éthique de la transparence photographique, distinguant clairement les images documentaires des créations artistiques modifiées.
Aujourd'hui, nous acceptons naturellement cette dualité, avec des conventions établies pour signaler les images retouchées dans la publicité ou le journalisme.
Cette démarche insiste sur le fait que l'utilisation de l'IA n'est pas un aveu de faiblesse mais un choix éclairé. La transparence renforce la confiance plutôt que de la diminuer, comme l'affirme le Manifeste pour la Transparence IA.
Exploiter la connaissance des limites pour mieux préparer l'avenir.
Pour accompagner efficacement cette transformation, les formateurs doivent comprendre les limites de l'IA pour mieux préparer leurs apprenants. Cette connaissance approfondie permet de concevoir des approches pédagogiques qui maximisent les avantages de l'IA tout en préservant les compétences essentielles.

Premièrement, l'IA actuelle manque de véritable pensée critique. Malgré sa capacité à générer du contenu convaincant, elle ne peut réellement évaluer la validité de ses propres productions. Cette limitation renforce l'importance d'enseigner l'analyse critique et le questionnement systématique des informations, qu'elles proviennent d'humains ou de machines.
Deuxièmement, l'IA reproduit des modèles existants mais peine à créer véritablement du nouveau. La créativité humaine implique la génération d'idées à la fois nouvelles et valables dans un contexte donné, ce que l'IA ne peut pleinement accomplir. Cette distinction renforce l'importance de cultiver la créativité humaine comme compétence fondamentale.
Troisièmement, l'IA fonctionne sur des données existantes, ce qui peut perpétuer des biais existants. Cette réalité souligne l'importance de l'acquisition de connaissances diversifiées et de la confrontation à des perspectives multiples.
Stratégies concrètes basées sur une connaissance approfondie.
Une utilisation éclairée de l'IA en formation nécessite des stratégies concrètes basées sur une compréhension précise de ses mécanismes :
- Intégration réfléchie : incorporer l'IA comme outil dans les processus d'apprentissage tout en explicitant ses limites, par exemple en démontrant comment les mêmes prompts peuvent générer des réponses contradictoires selon les contextes.
- Méthodologie de vérification : enseigner des protocoles systématiques de vérification des informations générées par l'IA, en s'appuyant sur des méthodes issues du journalisme et de la recherche académique.
- Évaluation adaptative : concentrer l'évaluation sur les compétences que l'IA ne peut reproduire (analyse critique, créativité, résolution de problèmes complexes), en concevant des tâches qui nécessitent la mobilisation de capacités spécifiquement humaines.
- Lecture stratégique : encourager la lecture approfondie en montrant sa valeur ajoutée par rapport aux résumés générés par l'IA, par exemple en comparant la richesse des nuances d'un texte original avec sa version synthétisée par une IA.
Les organisations qui tirent le meilleur parti de l'IA ne sont pas celles qui l'utilisent le plus intensivement, mais celles qui investissent simultanément dans le développement des compétences humaines complémentaires.
L’humain reste central dans tout débat concernant l’IA. Sans humain, pas d’usage d’IA. Sans usage, pas d’intérêt ou d’évolution réelle.
Cette observation du monde professionnel s'applique également au domaine éducatif. C’est d’ailleurs ce que je défend dans mes cours depuis de nombreuses années.
Vers une symbiose équilibrée.
L'avenir de l'éducation et de la formation ne réside ni dans le rejet de l'IA ni dans son adoption aveugle, mais dans la recherche d'un équilibre informé. La collaboration homme-machine, décrite dans le document sur l'IA comme catalyseur d'innovation, offre un modèle pertinent pour l'éducation du XXIe siècle.
L'adoption des ordinateurs personnels dans les années 1980 illustre parfaitement cette trajectoire. Au départ, de nombreux enseignants et professionnels craignaient que ces machines ne diminuent les capacités intellectuelles des élèves et travailleurs.
L'apprentissage de la programmation était considéré comme excessivement technique et réservé aux spécialistes. Les débats sur la pertinence d'introduire l'informatique à l'école faisaient rage. Trente ans plus tard, l'informatique est devenue si naturelle que nous ne remarquons même plus sa présence. Les compétences numériques sont désormais considérées comme fondamentales, au même titre que la lecture ou l'écriture.
Et si on y regarde bien, les nouvelles générations ne sont pas si douées que cela avec les ordinateurs. Il suffit de regarder l’usage du clavier, du copier-coller ou même d’observer la façon de ranger les fichiers en local ou en ligne (sur un cloud quoi) : souvent un beau bordel désorganisé, mais qui marche quand même.

L'IA générateur bouleverse nos pratiques, mais comme toute technologie, elle offre un potentiel qui dépend largement de notre capacité à l'utiliser judicieusement.
La formation à l'ère de l'IA doit viser une collaboration permettant de combiner le meilleur des deux mondes : la créativité, l'intuition et l'intelligence contextuelle des humains avec la capacité de traitement de données, la reconnaissance de motifs et la modélisation complexe de l'IA.
Donc bon.
Notre objectif n'est pas de lutter contre la technologie, mais d'éduquer des individus capables d'utiliser intelligemment ces outils tout en préservant les compétences fondamentales qui définissent notre humanité.
Pour cela, les formateurs eux-mêmes doivent adopter une posture d'apprentissage continu, en s'informant régulièrement des avancées technologiques, en expérimentant de nouvelles approches, et en partageant leurs expériences avec leurs pairs. Et en évitant le chant des sirènes sur LinkedIn.
C'est avec cet équilibre entre adoption éclairée et préservation des compétences essentielles que réside l'avenir de l'apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle.
*mic drop*